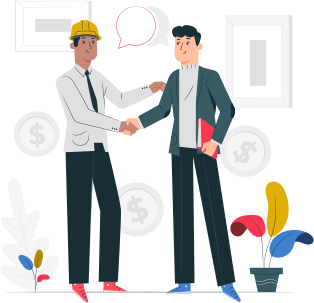1 janvier 2021
Promulgation de la loi ASAP : ses impacts sur le droit de l’environnement
Au cours des derniers mois, de nombreux acteurs, telles des sentinelles, ont pointé du doigt le risque d’une régression du droit de l’environnement, si cette loi venait à être promulguée. Sans doute à cause de l’ensemble des mesures prises, fondamentalement favorables aux porteurs de projets industriels. Après l’examen du Conseil constitutionnel, et sa promulgation le 7 décembre 2020, les avis ont-ils changé ? Pour faire simple, non, quand bien même l’analyse du juge constitutionnel n’ait pas relevé une telle régression s’agissant de la protection de l’environnement.
Le point sur lequel le Conseil constitutionnel était attendu, et auquel il n’a pas dérogé, porte sur les cavaliers législatifs. Il a déclaré contraire à la Constitution une multitude d’articles (26 au total) qui « ne présentent pas de lien, même indirect » avec les dispositions du projet de loi initial (application de la jurisprudence des cavaliers législatifs, chère au Conseil, consacrée par la décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985).
Le texte comprend 149 articles (moins les articles exclus par le Conseil), et s’articule en cinq parties :
- Titre Ier : Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives (Articles 1 à 24)
- Titre II : Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles (Articles 25 à 33)
- Titre III : Dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises (Articles 34 à 66)
- Titre IV : Diverses dispositions de simplification (Articles 67 à 139)
- Titre V : Dispositions portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français et diverses dispositions (Articles 140 à 149)
Six articles avaient été déférés par les députés en raison d’une hypothétique non-conformité à la Constitution, le Conseil a été clément car ils en sortent tous indemnes. Sur ces six articles, trois avaient été vivement critiqués en raison de leurs incidences potentielles sur l’environnement : l’article 34, l’article 44, et l’article 56. Les autres (131, 132, et 142) modifiant le code de la commande publique.
Ce qui change pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (« ICPE »)
L’article 34 de la loi ASAP, a été déclaré conforme à la Constitution, ces dispositions ne violant « ni l’article 1er ni l’article 3 de la Charte de l’environnement », comme souligné par les députés requérants. Il en résulte que les ICPE qui ont fait une demande d’autorisation complète (étant présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement), qui sont donc en cours d’instruction, auront un régime plus favorable pour se mettre en conformité avec de nouvelles prescriptions ministérielles en matière environnementale. Il est nécessaire de rappeler que « les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation », sont fixées par arrêté, par le ministre compétent. Il en est de même pour les installations soumises à autorisation simplifiée et certaines catégories d’installations soumises à déclaration. Par ailleurs, ces nouvelles prescriptions ne s’appliqueront pas aux projets en cours d’instruction ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté et aux installations existantes, dès lors qu’elles concernent le gros œuvre. Un site industriel ne pourra se voir imposer de modification du gros œuvre comme la mise en place de murs coupe-feu par exemple. Cependant, toutes ces mesures favorables aux exploitants, « ne sont pas applicables lorsqu’y fait obstacle un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne ».
S’agissant de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée, un tiers aura désormais la possibilité de se substituer à la personne demanderesse déjà substituée à l’exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation du site, dès lors que « l’usage prévu est identique » et qu’il dispose de capacités techniques suffisantes et de garanties financières pour la réalisation des travaux de réhabilitation (article 57). Il devra pour cela, adresser une demande au préfet.
Le renforcement des pouvoirs du préfet
Nouveauté prévue par l’article 58, la création d’un article L. 512-22 disposant que le préfet, après consultation de l’exploitant ou du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’EPCI compétent, « peut fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 » (réhabilitation et usage futur comparable à la dernière période d’activité).
Une autre nouveauté qui a son importance, à l’article 44, c’est la modification des modalités de consultation du public sur certains projets ayant des incidences sur l’environnement. Désormais, le préfet pourra recourir à une simple procédure de consultation par voie électronique au détriment d’une enquête publique, pour les projets soumis à autorisation environnementale. Rappelons que cette enquête vise non seulement à informer le public sur la création de projets, mais aussi permettre à tout citoyen de s’exprimer, ainsi qu’à l’autorité compétente de réunir les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Cette nouvelle disposition renforce les pouvoirs du préfet, puisque ce dernier pourra suppléer l’enquête publique s’il ne l’estime pas nécessaire, appréciant les conséquences du projet « sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire ». Mais elle sera requise lorsque le I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement l’exige (c’est-à-dire quand une évaluation environnementale est requise). Ainsi, la phase d’enquête publique devient l’exception, dans une logique d’accélération et de simplification des procédures d’aménagement, et d’instruction de l’autorisation environnementale.
Par ailleurs, la modification de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, induite par le paragraphe I de l’article 56, donne le pouvoir au préfet d’autoriser « l’exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance de l’autorisation environnementale ». C’est une dérogation explicite à l’article L. 181-30. Cependant, l’approbation de cette exécution anticipée doit résulter d’une demande du pétitionnaire et est prise à ses frais et risques. Cette disposition a été fermement combattue par les députés, qui estimaient à juste titre, que le verrou, la sécurité, apportée par l’autorisation environnementale, sauterait et que le risque qu’une atteinte irréversible à l’environnement pourrait être causée. En vérité, le filet que représente cette autorisation, ne retiendrait plus rien, c’était la crainte des parlementaires. Sur ce point, le Conseil constitutionnel rappelle que : « cette autorisation ne peut intervenir qu’après que la possibilité de commencer les travaux […] a été portée à la connaissance du public dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l’article L. 181-9 du code de l’environnement ou en application du paragraphe I de l’article L. 181-10 de ce même code ». Par ailleurs, s’agissant de cette fameuse autorisation préfectorale d’exécuter de manière anticipée certains travaux, elle répond à certaines exigences ; « la décision spéciale, […] doit être motivée et désigner les travaux dont l’exécution peut être anticipée, ne peut elle-même être prise avant l’expiration du délai courant à partir de la fin de cette procédure de consultation et fait l’objet des mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale ». Enfin, tous les travaux ne sont pas éligibles à cette exécution anticipée. L’article 56, modifiant l’article L. 181-30, dispose : « cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3 ». Autrement dit, les aménagements qui nécessitent une autorisation spéciale ne sont pas concernés (l’autorisation de défrichement par exemple, ce qui semble assez logique).
Nous pouvons également évoquer le fait que le délai dans lequel peut s’exercer le droit d’initiative en matière de concertation préalable, issu de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, a été raccourci. Il est désormais de deux mois, alors qu’avant il était de quatre. Les modalités de consultation du public sur les procédures de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer, sont également modifiées. L’autorisation environnementale tient lieu de dérogation motivée au respect des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE, et d’autorisation pour les projets d’infrastructure terrestre liée à la circulation routière ou ferroviaire…
Enfin, sont vivement attendus dans les prochains mois, quelques décrets qui viendront préciser les modalités d’application de certaines dispositions. C’est le cas notamment, de l’intervention d’une « entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués » pour attester de la « mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site ». Ou encore de la possibilité d’entreprendre des travaux « destinés à prévenir un danger grave et immédiat […] sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé » s’agissant des installations, ouvrages, travaux et activités (« IOTA »).
7 juillet 2023
Le projet de création de l’homicide routier
Une proposition de loi créant l'homicide routier et renforçant les...
16 mai 2023
On fait le point sur la pollution lumineuse
La Journée Internationale de la Lumière Depuis 2018, la Journée...
28 novembre 2023
Règlement du jeu-concours « calendrier de l’avent 2023 Les Expert HSE Perform »
Article 1 - Organisation Le présent jeu-concours est organisé par...