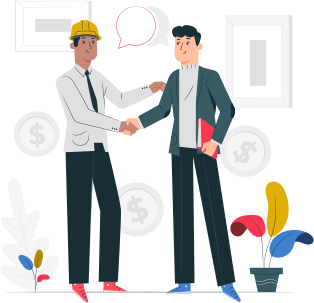Des modèles économiques difficilement tenables
Depuis les années 2000, les territoires européens ont accéléré leurs mesures pour lutter contre le changement climatique notamment en développant des moyens de production d’énergies alternatives (solaire, éolien…) ou en développant des moyens de transports utilisant de nouvelles énergies (électricité, hydrogène…). Il s’agit de deux des leviers principaux pour réduire nos consommations d’énergie, et donc inverser la tendance dans les émissions de gaz à effet de serre.
Ces nouvelles technologies ont une consommation de ressources minérales très importantes. Par exemple, les véhicules électrifiés ont besoin de cobalt, cuivre, lanthane, lithium ; les piles à combustible de platine, palladium, rhodium ; les technologies de l’éolien de cuivre, de néodyme, de dysprosium, de terbium ; les technologies du solaire photovoltaïque de silicium, de cuivre, de cadmium, de indium, gallium ; les batteries de lithium, de cobalt, de nickel.[1] La consommation de ces métaux n’a cessé d’augmenter ces 20 dernières années notamment les métaux très rares (concentration dans l’écorce terrestre inférieure à 1 ppm).
Or, force est de constater que la production de ces métaux à de forts impacts environnementaux (consommation importante d’énergie, pollution de l’environnement par l’extraction, le raffinage et la transformation de ces ressources).
Alors que la transition énergétique de nos sociétés actuelles devrait s’accélérer dans les prochaines années, afin de respecter les engagements mondiaux en matière de réduction des émissions de GES et de limiter les effets du changement climatique, cette transition va engendrer en parallèle un accroissement de la consommation de ces métaux dont la quantité est limitée.
Les sociétés modernes doivent donc se transformer pour préserver ces ressources, lutter contre le gaspillage et réduire nos déchets. Mais est-ce réellement le cas ?