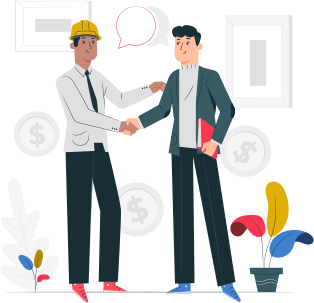Le Conseil d’Etat apporte des précisions quant aux pouvoirs du préfet
Le Conseil d’Etat apporte des précisions quant aux pouvoirs du préfet
La plus haute juridiction administrative française se retrouve notamment confrontée à un problème, qui trouve sa source dans la multiplicité des autorisations dont l’exploitant devait se munir avant la création de l’autorisation environnementale en 2017 ; l’articulation de deux décisions administratives distinctes, l’autorisation d’exploiter et la dérogation au principe de protection des espèces, ainsi qu’en une problématique de droit transitoire (l’application de la loi instaurant l’autorisation unique, dans le temps). Pour rappel, en l’espèce, ce n’était pas l’autorisation d’exploiter qui s’était vue annulée mais la dérogation au régime des espèces protégées prise sur le fondement de l’article L.411-2 du code de l’environnement.
Au regard des éléments de droit, le Conseil d’État a considéré, conformément à une décision antérieure (CE 22 juillet 2020, n° 429610), que l’autorisation environnementale était incomplète en raison de l’annulation de la dérogation au principe de protection des espèces. L’autorisation environnementale, par son incomplétude, ne pouvait alors être considérée comme conforme. L’exploitation du site devait donc être considérée comme irrégulière et il revenait ainsi au représentant de l’État dans le département d’appliquer les dispositions de l’article L.171-7 du code de l’environnement, lequel précise les mesures et sanctions que l’autorité administrative peut prendre lorsqu’un exploitant est en situation irrégulière (mise en demeure de l’exploitant, mesures conservatoires, suspension de l’exploitation…).
Le Conseil d’État a donc prononcé l’annulation de l’ordonnance du juge des référés, et a rejeté la demande présentée par la société devant ce même juge du tribunal administratif de Besançon.
Toutefois, la Haute juridiction ne fait pas table-rase des évènements passés, puisqu’effectivement, lorsque la société a commencé à exploiter son site, cette dernière bénéficiait d’une dérogation tout à fait licite, et ce n’est qu’après les annulations successives que l’exploitant s’est retrouvé en situation irrégulière (bien que ces annulations relèvent d’un problème de fond). Ce cas de figure symbolise sans aucun doute la hantise des exploitants. C’est également une décision qui rappelle aux exploitants de faire preuve de prudence notamment pour les projets soumis à autorisation environnementale car en l’espèce, la société avait pris la décision d’exploiter le site quand bien même un recours en justice était encore pendant et dont le résultat était plus qu’incertain.
Ainsi, les 6ème et 5ème chambres précisent qu’il incombe au préfet de : « rechercher si l’exploitation peut légalement être poursuivie en imposant à l’exploitant, par la voie d’une décision modificative de l’autorisation environnementale si elle existe ou par une nouvelle autorisation environnementale, des prescriptions complémentaires ». De plus, « ces prescriptions complémentaires comportent nécessairement les mesures de compensation qui étaient prévues par la dérogation annulée, ou des mesures équivalentes, mais également, le cas échéant, des conditions de remise en état supplémentaires tenant compte du caractère illégal des atteintes portées aux espèces protégées, voire l’adaptation des conditions de l’exploitation et notamment sa durée ».
En d’autres termes, le préfet doit tout de même essayer de concilier la situation de l’exploitant avec la réglementation, lorsque cela est possible, bien entendu. Quant à l’exploitant, il ne peut se prévaloir d’une décision préfectorale antérieure mais déclarée nulle par la suite, pour échapper aux obligations qui lui incombent : en l’espèce le respect de la réglementation afférente aux espèces protégées.