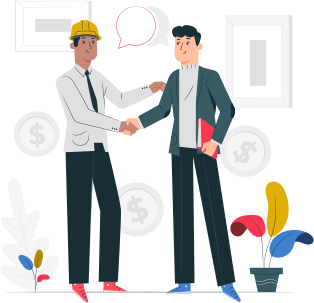Contenu d’un texte hétéroclite
- Moins de contraintes (environnementales) pour les entreprises :
Les instigateurs de ce texte se sont entretenus avec les grands patrons, et ont tendus une oreille attentive à leurs complaintes. Leur objectif : accélérer la création et l’extension d’installations industrielles et développer ou relocaliser l’activité et les emplois dans les territoires. Les conséquences (néfastes) : des risques accrus pour la sécurité (un an après Lubrizol), et des menaces pour la biodiversité. D’aucun parle de régression de la protection de l’environnement, et d’autres, de dé-tricotage. Quoi qu’il en soit, tout porte à croire, qu’avec ces mesures, le choix a été fait ; privilégier la vie économique à la défense de l’environnement.
Par exemple, le droit des installations classées (ICPE) serait assoupli. Il est notamment prévu de donner la faculté au préfet de décider entre une consultation du public en ligne ou une enquête publique pour certains projets soumis à procédure d’autorisation (comme les ICPE), mais non soumis à évaluation environnementale.
Un changement de réglementation applicable alors qu’un projet d’installation industrielle serait en cours, n’aurait que peu d’incidence en vertu d’un nouveau principe inscrit dans la loi, le principe de non-rétroactivité des prescriptions nouvelles affectant le gros œuvre. Bien entendu, il pourrait faire l’objet de dérogations s’agissant de la sécurité, de la santé, ou de la salubrité publiques. Plus généralement, l’objectif est de sécuriser les porteurs de projet ; leur garantir l’application de la réglementation des installations existantes lors du dépôt d’un dossier, même si de nouvelles règles entrent en vigueur durant son instruction.
Pour ce qui est des études d’impact, l’entrée en vigueur de cette loi emportera des changements quant au mécanisme d’actualisation de celles-ci (pour les procédures engagées après son entrée en vigueur). L’autorité environnementale ne pourra revenir sur les éléments déjà autorisés, et dans le cadre d’une réglementation nouvelle, celle-ci ne s’appliquera que sur ce qui a fait l’objet de la demande. Cela traduit une volonté de simplifier les démarches pour les industriels : « actualiser » l’étude d’impact, sans avoir à reprendre à zéro l’ensemble des études nécessaires.
De même, les règles de consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (« CODERST ») ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), le cas échéant, sont modifiées (optionnelles dans plusieurs cas).
Mais ce n’est pas tout ! Le texte comporte pléthore d’autres dispositions portant notamment sur :
- La suppression ou le regroupement de commissions consultatives (suppression de l’Observatoire de la récidive, du Conseil supérieur de la mutualité, …).
- Des décisions administratives plus proches des territoires (pouvoir renforcé du préfet au détriment de la voie législative).
- Des mesures de simplification administrative pour les citoyens (justificatif pour l’obtention de carte nationale d’identité, de passeport ou de permis de conduire, procédure d’inscription à l’examen pratique du permis de conduire…).
- Des habilitations du gouvernement à légiférer par ordonnances (élargissement des possibilités de recrutement de contractuels de droit privé par l’Office National des Forêts, de même pour les personnes chargées d’encadrer les volontaires du Service National Universel).
- Une meilleure information des maires sur les projets d’installations éoliennes et des procédures simplifiées sur l’éolien en mer.
- Un renforcement de la procédure administrative d’expulsion des squatteurs.
- Des modifications des règles de la commande publique.